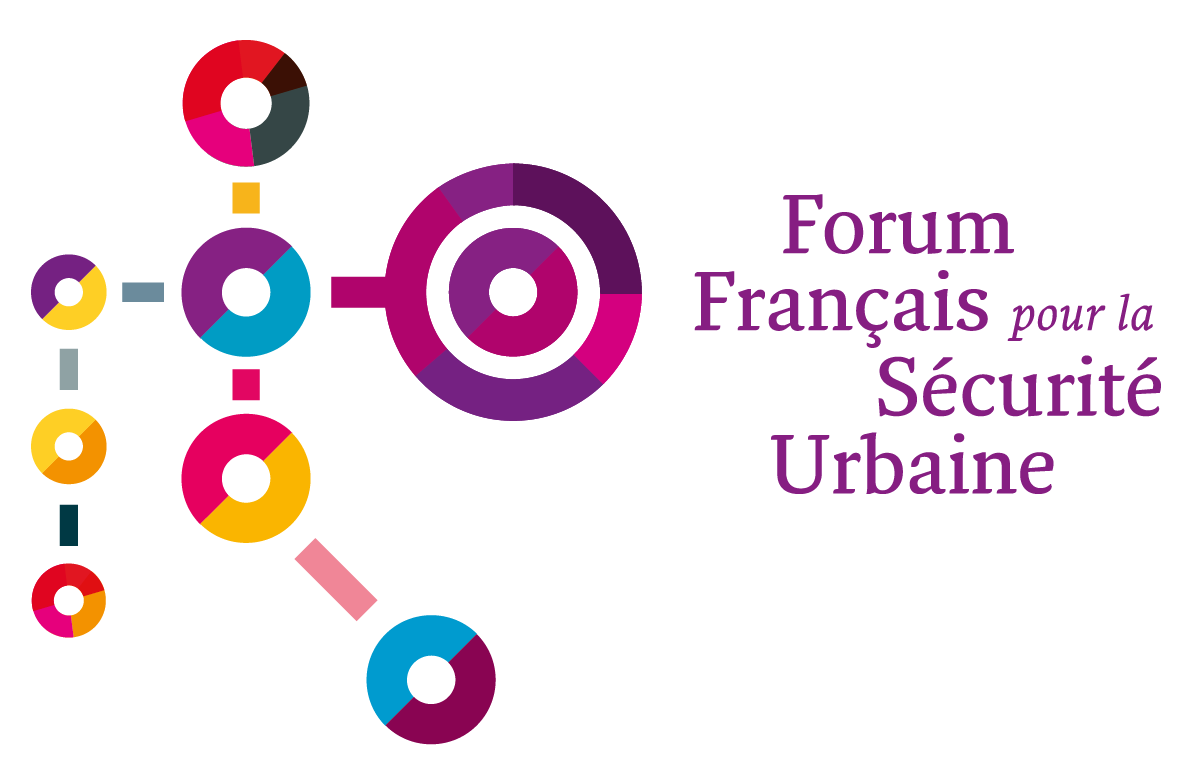Plusieurs collectivités locales membres et organisations partenaires du FFSU se sont réunies, le 29 janvier 2020, et pour la troisième fois depuis mai 2018, dans le cadre du groupe de travail piloté par les villes de Bordeaux et Brest pour améliorer la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA) victimes et/ou auteurs d’actes de délinquance.
Les villes d’Aubervilliers, Bordeaux, Brest Lyon, Montpellier, Paris et Rennes étaient représentées ainsi que la Direction centrale de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), des représentants de la PJJ de Bordeaux, l’Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF), l’association Trajectoires et le Centre d’action sociale protestant (CASP). La diversité des participants a produit des échanges riches et constructifs.
Un phénomène cyclique qui met en difficulté les politiques publiques habituelles
Le groupe de travail ne s’intéresse pas à l’ensemble des mineurs non accompagnés (relevant de la protection de l’enfance) mais à une infime partie d’entre eux que l’on retrouve dans les phénomènes de délinquance, en tant que victimes et/ou auteurs. Cette problématique est désormais inscrite dans les préoccupations des pouvoirs publics locaux dont les villes et leurs partenaires territoriaux ont pris la mesure depuis quelques années. Si l’intensité du phénomène est fluctuante selon les aires géographiques, il reste cyclique et se répète régulièrement.
Ces jeunes semblent souvent sous l’emprise de réseaux locaux, régionaux, nationaux ou même internationaux qui organisent les activités délinquantes (vols, vols à l’arraché, cambriolages), les mineurs sont mobiles et se déplacent facilement d’une ville à l’autre en France mais également à travers l’Europe entre l’Espagne, le Benelux, jusqu’en Suède. En perpétuel déplacement, ils retournent régulièrement dans les villes déjà fréquentées. Cela représente une première difficulté pour leur prise en charge.
Les participants soulignent la nécessité d’intégrer dans leur prise en charge le fait que ces jeunes sont très souvent victimes autant qu’auteurs d’actes de délinquance. Ils sont souvent très isolés et éloignés des dispositifs de prise en charge, victimes de violences physiques et psychologiques, en mauvaise santé liée à des poly-consommations de stupéfiants, des automutilations ou maladies. Ces difficultés les rendent extrêmement vulnérables aux réseaux de criminalité organisés dont ils sont également les victimes..
Ces mineurs s’avèrent très difficiles à approcher et accompagner, aussi bien pour les acteurs du champs social que de la chaîne pénale. Ils refusent en grande majorité tout accompagnement des acteurs sociaux-éducatifs et développent des stratégies pour entraver les actions policières et judiciaires. La difficulté à les identifier en raison de l’absence de documents d’identité et de l’utilisation d’alias est notamment une problématique sur laquelle butent aujourd’hui policiers et magistrats.
Une préoccupation constante des acteurs de la sécurité, des modes d’actions à construire
Les participants du groupe s’accordent sur un point : la réponse publique doit être innovante et partenariale pour répondre aux spécificités de ces jeunes. Si plusieurs collectivités travaillent sur ce sujet avec les partenaires locaux (Département, PJJ, Police nationale, Parquet), d’autres villes déplorent un cloisonnement encore trop important des réponses publiques. Les défauts de concertation génèrent des actions antagonistes, non partagées ou même un défaut de prise en charge de cette problématique. Une même analyse du phénomène, une mise en commun des informations et une coordination des acteurs sont des éléments indispensables pour améliorer la prise en charge de ces mineurs non accompagnés. Une harmonisation nationale est souhaitée par les membres du groupe.
Exemple de Brest : la Ville de Brest et la PJJ financent conjointement un Dispositif d’accompagnement des mineurs étrangers en errance (DAMEE), maraude sociale qui vise une approche éducative et l’orientation des jeunes rencontrés vers des structures du territoire.
Une collaboration accrue entre acteurs et une continuité des équipes doivent faciliter l’identification des individus et leur repérage, préalable à l’amorce d’une approche sociale et à un éventuel placement hors de la rue . A ce sujet, les participants du groupe souhaiteraient étudier la faisabilité d’un réseau de familles d’accueil volontaires et sensibilisées à la prise en charge de mineurs non accompagnés.
Le travail de terrain des associations et organisations locales peut se compléter par des échanges de données et de pratiques pertinentes dans les pays européens identifiés comme fréquentés par ces MNA : Espagne, Belgique, Pays-Bas ou même Suède. De même, un regain de l’investigation policière est nécessaire pour appuyer les actions locales quotidiennes et mettre à jour ces réseaux français et européen qui profitent de la fragilité des MNA pour s’enrichir.
Le groupe de travail doit permettre d’enrichir les pratiques des acteurs locaux.et de nourrir les recommandations du FFSU sur cette problématique que nous porterons auprès des instances nationales et européennes concernées. La participation aux travaux de ce groupe est ouverte aux collectivités membres du FFSU.
>>> En savoir plus sur le groupe de travail